- PHARMACOLOGIE
- PHARMACOLOGIEDans son sens le plus restreint, la pharmacologie est la science des médicaments. Mais une telle définition ne peut actuellement satisfaire un pharmacologue, car la différence entre médicament, poison et substance jouant un rôle hormonal ou neurohumoral n’est pas claire et dépend souvent de la dose utilisée et de l’orientation de la recherche. En revanche, la définition proposée par T. Sollmann apparaît beaucoup plus satisfaisante; elle confère, en outre, à cette discipline une valeur de science fondamentale: la pharmacologie est la science qui étudie les effets du milieu chimique environnant sur la matière vivante. De ce milieu chimique, sont exclus les corps qui participent au métabolisme cellulaire et qui, de ce fait, sont l’objet de la biochimie. Toute substance capable de perturber les mécanismes physiologiques est une drogue; les médicaments sont des drogues employées à des fins thérapeutiques. Par suite, la pharmacologie se trouve au carrefour de la physiologie, de la biochimie, de la biophysique et de la physiopathologie. Seuls la nature d’un certain nombre de problèmes, la façon de les envisager et l’élaboration de concepts la différencient et lui confèrent son individualité.Pour expliquer le mécanisme d’action des médicaments, la pharmacologie doit s’intéresser aux phénomènes se produisant au niveau moléculaire et suivre les progrès de la biochimie et de la biologie moléculaire. Elle deviendrait alors «la science des interactions des molécules chimiques avec la matière vivante». Dans cet esprit, le terme de pharmacologie moléculaire apparaît dans les ouvrages, les revues et les congrès de pharmacologie. La définiton et les limites de cette science restent cependant encore imprécises.0. Les branches de la pharmacologieIl est donc d’usage de rappeler que la pharmacologie se divise en six parties:– La pharmacognosie étudie les sources des drogues naturelles et leurs principes actifs. Elle aide à reconnaître ces dernières selon des critères botaniques ou physicochimiques. Anciennement appelée «matière médicale», la pharmacognosie joue le rôle d’intermédiaire entre la chimie, la botanique et la pharmacodynamie.– La pharmacodynamie s’intéresse aux perturbations physiologiques provoquées par les drogues sur l’organisme sain ou malade (pathopharmacodynamie). Branche la plus active, la plus vivante et la plus riche de la pharmacologie, elle tend à l’heure actuelle à expliquer l’action exercée par les drogues, en relation avec des perturbations de mécanismes biochimiques ou biophysiques.– La pharmacocinétique étudie la destinée des substances chimiques dans l’organisme: absorption, liaison aux protéines plasmatiques, distribution, métabolisme, excrétion. Son importance fut pressentie par Otto Schmiedeberg au siècle dernier; ses lois ont été énoncées en 1937 par T. Theorell. L’émergence de cette sous-discipline est la conséquence de l’évolution rapide des méthodes d’analyse chimique. Les applications pratiques de la pharmacocinétique sont très importantes pour la poursuite d’un traitement. Elles visent à obtenir des concentrations plasmatiques efficaces et inférieures aux concentrations toxiques. La pharmacocinétique conditionne les doses d’attaque, les doses d’entretien, la fréquence des administrations. Le dosage des médicaments dans le sang permet la surveillance du traitement. La demi-vie biologique d’une substance est le temps au bout duquel ne reste dans l’organisme que 50 p. 100 de la dose administrée. C’est la durée généralement prise en compte pour une réadministration.– La toxicologie a pour but d’étudier les effets nocifs des drogues, conséquences de leurs propriétés pharmacologiques. Ces effets se manifestent lorsque la drogue possède des actions indésirables, mais inséparables de son effet thérapeutique, ou qu’un dosage trop élevé a été employé, ou qu’un individu se révèle particulièrement sensible à l’une d’entre elles, ou encore qu’apparaissent des propriétés pharmacologiques inhabituelles. Parfois la drogue, en s’unissant à des protéines du sang, suscite la formation d’anticorps, et provoque lors d’une administration ultérieure des réactions allergiques. Ce conflit antigène-anticorps trouve de plus en plus son explication dans l’immunologie [cf. ALLERGIE ET HYPERSENSIBILITÉ]. Parfois encore la drogue déclenche l’apparition de maladies évoluant pour leur propre compte même après l’arrêt de la médication: néphrose lipoïdique causée par la triméthadione, lupus érythémateux dû aux hydralazines, hépatite, néphrite, etc.– La pharmacie étudie les formes d’administration des médicaments chez l’homme. Actuellement, elle a encore une importance majeure, mais avec l’avènement des spécialités elle est passée de l’âge artisanal à l’âge industriel. La pharmacie comporte une branche importante: l’étude de la biodisponibilité. On désigne par ce terme la fraction absorbée de la drogue présente dans une forme pharmaceutique; suivant la composition de cette forme, elle peut varier considérablement.– La pharmacothérapie , qui représente aujourd’hui au moins 80 p. 100 de la thérapeutique, est l’application des drogues au traitement des maladies humaines [cf. THÉRAPEUTIQUE]. La chimiothérapie est une partie spéciale de la pharmacologie en ce sens qu’elle vise à perturber une chaîne métabolique spécifique du micro-organisme, sans entraîner de troubles chez l’hôte infecté par cet agent pathogène.La découverte d’un nouveau médicament dépend de la voie de recherche adoptée. On peut partir d’une approche pharmacodynamique: en présence d’une maladie donnée, on cherche à déterminer, par la théorie, quels sont les corps chimiques capables de modifier, dans le sens bénéfique, un chaînon physiologique ou physiopathologique. Une deuxième méthode consiste à prendre un point de départ chimique: dans ce cas, on synthétise toutes les molécules possibles dans une série de corps peu étudiée jusque-là, puis on les soumet à un tamisage (screening ) pour rechercher systématiquement toutes leurs propriétés pharmacologiques. Une troisième méthode consiste à isoler le principe actif d’une plante ou d’un organe animal, à l’identifier et à essayer de le reproduire par synthèse.La pharmacologie est également d’un emploi fréquent en art vétérinaire et dans la lutte biologique (cf. PESTICIDES et LUTTE BIOLOGIQUE).0. La pharmacologie des origines à nos joursSelon Auguste Comte, on ne connaît bien une science que si on peut en tracer l’histoire; on essayera donc de brosser un rapide historique de la pharmacologie.De l’âge magique aux découvertes des «chimiatres»Les origines sont lointaines et datent vraisemblablement des âges préhistoriques. Nos ancêtres arboricoles avaient probablement remarqué les effets sur l’organisme des narcotiques, tel l’opium, ainsi que les propriétés cathartiques de certaines plantes. L’utilisation par les peuplades primitives de stimulants, d’hypnotiques et de poisons pour la chasse ou la pêche appuie cette hypothèse. Les effets de l’alcool sur le comportement humain furent aussi remarqués et utilisés très tôt.Cependant, la pharmacologie, comme la médecine, n’était pas séparée de la philosophie et de la religion. Les explications étaient entachées de mysticisme et souvent mal rapportées à leurs causes réelles, bien que l’observation des effets fût assez poussée. Il y a de bonnes raisons de penser que la psychopharmacologie était utilisée à une large échelle et que les drogues hallucinogènes étaient employées par les mages, les prophètes et la pythie, au cours de la célébration des mystères d’Eleusis. En outre, de nombreuses légendes pourraient avoir été créées en raison de l’usage de ces drogues. Toutefois, l’état psychologique n’était pas rapporté à l’effet de la drogue, mais permettait, croyait-on, une communication plus aisée avec les dieux.Les Égyptiens connaissaient les effets diurétiques de la scille et faisaient usage du bicarbonate de sodium et de l’alun comme le rapporte le papyrus d’Ebers. Les drogues étaient à ce point recherchées que le pharaon Thotmès III entreprit une expédition militaire en Syrie, notamment, pour se procurer des plantes médicamenteuses.Les Grecs utilisèrent de nombreuses plantes. Théophraste, en l’an 350 avant J.-C., décrivit quatre cent cinquante plantes médicinales dans son herbier. Hippocrate (Ve s. av. J.-C.) sépara, le premier, la médecine de la magie et de la religion. Bien que sa médecine fût surtout expectative, il utilisa néanmoins trois cent cinquante plantes dont la belladone, la jusquiame, l’opium, la vératrine. L’herbier de Dioscoride (Ier s. apr. J.-C.) contient la description de cinq cents plantes.Les Romains, héritiers des Grecs, utilisèrent aussi les ressources de la botanique, et Galien (IIe s. apr. J.-C.) décrit quatre cents plantes médicinales, et la pharmacie galénique désigne depuis la partie de la pharmacologie utilisant des extraits de plantes. Pline l’Ancien (Ier s. apr. J.-C.) mentionne les effets narcotiques de l’opium et les propriétés diurétiques de la scille. Arpuleius connaissait les effets cathartiques de la coloquinte, ceux de la mandragore sur le système nerveux central. Et sous l’Empire romain, les empoisonneurs exploitaient les propriétés toxiques de nombreuses plantes. Toutefois, aucun travail expérimental n’avait lieu et les connaissances étaient purement empiriques et entachées de mysticisme. À la disparition de l’Empire romain, l’art de guérir se transmit et se développa dans les monastères de la chrétienté et dans l’Empire arabe.Aux Indes, on faisait un usage millénaire de nombreuses plantes, ainsi Rauwolfia serpentina dans le traitement de la folie. Cette plante et son alcaloïde actif, la réserpine, furent introduits en 1950 dans la médecine occidentale pour traiter la manie et l’hypertension (cf. NEUROPHARMACOLOGIE et PSYCHOPHARMACOLOGIE). Depuis, la réserpine a suscité, au sujet de son mécanisme d’action, de très nombreux travaux qui ont ouvert une ère nouvelle en pharmacologie; en effet, elle a permis aux chercheurs, d’une part, de pressentir l’importance des médiateurs chimiques dans les mécanismes psychophysiologiques, d’autre part, d’entreprendre une analyse biochimique détaillée du système nerveux sympathique [cf. NEUROCHIMIE].Souvent, la découverte des propriétés pharmacologiques des drogues fait l’objet de légendes hautes en couleur. Ainsi, un bodhisattva avait fait vœu de contempler les vertus du bouddha pendant neuf ans sans dormir. Il s’assit donc sous un arbre, mais s’endormit la troisième année. Les dieux eurent pitié de lui et une feuille de l’arbre tomba sur ses paupières et le réveilla. Ainsi naquit le thé... En Arabie, un im m était ulcéré de la somnolence de ses ouailles durant la prière. Un jour, jetant un regard à l’extérieur, il voit un chameau danser après avoir mangé les fruits d’un arbre, le caféier. Ainsi se répandit l’usage du café. Vers la fin du Moyen Âge, une renaissance de la pharmacothérapie se développa en Italie, en particulier à Bologne et Padoue, et en Angleterre, à Oxford. On rejeta l’autorité des Anciens, et la médecine se sépara définitivement de la philosophie ou de la religion. À cette époque vivait un personnage étonnant, Theophrastus Bombatus von Hohenheim (1493-1541), dit Philippus Aureolus Paracelsus. Ce médecin suisse, dont l’herbier est célèbre, refusa véhémentement l’autorité des Grecs. Lié avec les alchimistes, il introduisit en thérapeutique les composés minéraux. De ce fait, il fut le premier des chimiatres (expression méprisante en usage au Moyen Âge), mais aussi le précurseur de la chimiothérapie.En ce temps fut introduite la thérapeutique de la syphilis par le mercure: Rabelais ne prétendait-il pas que les syphilitiques devaient être isolés dans une chambre noire et soignés jusqu’à la perte de leurs dents par des administrations de ce métal [cf. SYPHILIS]? On peut pressentir ainsi qu’il faut quelquefois aller jusqu’à un phénomène toxique pour obtenir un effet thérapeutique majeur.Tous les chimiatres ne furent pas aussi heureux que Paracelse. Un de ses disciples, Basile Valentin, remarqua que le stibium faisait engraisser les porcs. Il eut l’idée de le prescrire aux moines amaigris par les jeûnes prolongés. Comme tous les moines moururent, le stibium fut appelé «antimoine» et banni de la thérapeutique. Ce n’est qu’au XVIIe siècle, à la suite de la guérison grâce à l’antimoine de Louis XIV encore jeune, que ce corps fut à nouveau prescrit. Au XXe siècle, de nombreux antimoniaux organiques furent ensuite utilisés dans le traitement des maladies parasitaires, telles que les bilharzioses et les leishmanioses.En 1630, Thuillier rapporta le «mal des ardents», si fréquent jusqu’alors, à l’intoxication par des graminées parasitées par l’ergot de seigle. W. Harvey découvrit la circulation du sang; R. Boyle et T. Clark pratiquèrent les premières injections intraveineuses d’extrait d’opium; J. Wepfer (1679) étudia la toxicité de la ciguë.L’âge expérimentalC’est en 1755 que Menghini effectua, sur le camphre, le premier travail expérimental de pharmacologie. P. Daries décrivit la mydriase provoquée par la belladone. En 1785, W. Withering introduisit la digitale pour le traitement des œdèmes dans son célèbre opuscule: An Account on Foxglove .Au début du XIXe siècle commença l’extraction, à partir des végétaux, des «principes actifs»: morphine par F. W. Sertürner, quinine par J. Pelletier et J. Caventou, émétine par J. Pelletier et F. Magendie.Magendie, expérimentateur de génie, proclama la primauté de l’expérimentation et rejeta les systèmes médicaux. Il étudia le mécanisme des convulsions provoquées par la strychnine, et démontra que cet alcaloïde agit au niveau de la moelle épinière. Ses expériences servirent de modèle à son disciple, Claude Bernard, dans ses célèbres travaux sur le curare. Claude Bernard exposa les bases de la méthode expérimentale, et son Introduction à la médecine expérimentale constitue un des points de départ essentiels de la recherche expérimentale en biologie. Il fut le promoteur de l’étude expérimentale des médicaments comme le témoignent ses leçons sur les toxiques, l’anesthésie, etc. La pharmacologie moderne était née. Mais le premier laboratoire de pharmacologie fut créé à Dorpat, en Lithuanie; son directeur, R. Buchheim, y étudia l’atropine, l’ergot et occupa la première chaire de pharmacologie.Les progrès de la chimie industrielle fournirent de nouveaux composés chimiques nécessaires à l’épanouissement de la pharmacologie. Il n’est donc pas étonnant que cette dernière ait connu un développement rapide en Allemagne, où O. Schmiedeberg dirigea une école de réputation internationale. Il exposa les problèmes fondamentaux de la pharmacologie: mécanisme d’action des drogues à un stade plus élémentaire (organes isolés), destinée des médicaments dans les organismes.En 1906, P. Ehrlich pensait que l’activité antiparasitaire de certaines molécules est liée à la présence d’un groupement chromophore, tel que 漣N 略 N 漣 ou 漣As 略 As 漣, qui permettrait la fixation de la molécule sur un «récepteur». Cette idée fut à l’origine de la synthèse des arsenicaux trivalents. P. Ehrlich fut donc le créateur de la chimiothérapie moderne, dont il établit les premières lois.En Angleterre, la pharmacologie prit aussi un grand essor, et A. J. Clark décrivit les lois d’action des médicaments.La pharmacologie, qui n’a cessé de progresser, est actuellement une des disciplines les plus vivantes et les plus fécondes de la biologie et de la médecine.0. Les buts de la pharmacologieLa pharmacologie se propose d’abord de découvrir de nouvelles drogues. Elle cherche ensuite à localiser leur lieu d’action et à comprendre le mécanisme de cette action.Observer qu’un médicament agit sur le cœur en entraînant une accélération ou un ralentissement de ses battements intéresse beaucoup le clinicien, mais n’explique rien. Il faut, en effet, comprendre ce qui se passe au niveau cellulaire ou subcellulaire, déterminer les modifications biochimiques ou biophysiques induites par cette drogue, la manière dont elles sont induites et les phénomènes qui en résultent. En outre, les drogues peuvent servir aussi bien d’instrument de recherche que de médicaments en perturbant des mécanismes physiologiques ou pathologiques. De ce fait, la pharmacologie est non seulement une science appliquée, mais également une science fondamentale. On conçoit que ses méthodes soient souvent empruntées à d’autres disciplines telles que, par exemple, la physiologie, la biochimie, la bactériologie, la biophysique. Toutefois, certains problèmes sont typiques de la pharmacologie par la façon dont ils sont abordés.Modes d’action des médicamentsLes effets d’une drogue dépendent de sa dose, ou de sa concentration, suivant une loi qui s’exprime graphiquement, en coordonnées semi-logarithmiques, par une sigmoïde.À ces effets quantitatifs se superposent parfois des variations qualitatives: l’effet s’inverse avec la dose. Ainsi, l’adrénaline, souvent hypotensive à faibles doses, devient hypertensive à doses plus élevées. Cette inversion peut s’expliquer par l’action de cette amine sur deux systèmes de sensibilité différente qui ont des actions opposées sur la pression artérielle.Théories des récepteurs.Toute science, au cours de son évolution, subit une profonde transformation qui la fait passer du stade descriptif au stade explicatif. Alors, de nombreuses observations et hypothèses disséminées s’organisent autour de quelques grands principes directeurs. La discipline devient ainsi plus logique. La pharmacologie a progressivement subi cette transformation autour du concept de récepteurs . Celui-ci fut émis dès la fin du siècle dernier par le physiologiste anglais J. N. Langley, et repris au début du XXe siècle par Paul Ehrlich. Toutefois, ce n’est que progressivement, au cours des soixante-dix premières années de ce siècle, que ce principe s’imposa à la grande majorité des pharmacologues, et seulement au cours des dix dernières années que fut mis en évidence sa nature physico-chimique.Une drogue peut se fixer sur de nombreuses molécules de l’organisme, mais c’est pourtant sur un groupe bien déterminé, qu’elle induit ses effets pharmacologiques. Ainsi, un récepteur apparaît comme un site généralement macromoléculaire que retient la drogue pour produire ses effets. Les autres sites, auxquels elle se lie sans provoquer d’effets, sont appelés accepteurs .La liaison de la drogue avec le récepteur revêt certaines caractéristiques; cette interaction suppose une haute affinité de l’une pour l’autre. Ainsi, in vitro , on constate que des concentrations de la drogue aussi faible que 10-11 - 10-9 moles sont suffisantes pour marquer les récepteurs et induire une réaction pharmacologique. La fixation est saturable, c’est-à-dire qu’elle augmente rapidement en fonction de la concentration de la drogue pour atteindre un plateau; le nombre de récepteurs est donc limité, et le processus réversible – en tout cas généralement – c’est-à-dire que le lavage par une solution convenable suffit à dissocier le complexe drogue-récepteur. Les liaisons chimiques sont de type ionique, ou à faible énergie (liaison de Van der Waals, hydrogène). Toutefois, certaines substances se lient irréversiblement aux récepteurs, suggérant des liaisons covalentielles. La fixation est spécifique, c’est-à-dire que la drogue fixée ne peut être déplacée que par des substances qui induisent une réaction pharmacologique identique ou sont antagonistes. En fait, ce critère est seulement relatif et dépend de la faculté de produire, par synthèse chimique, des dérivés de plus en plus spécifiques d’un type de récepteurs ce qui est d’un grand intérêt pour la thérapeutique. On voit ainsi combien est artificielle la distinction entre substances naturelles et substances chimiques.Le fait que des substances exogènes se fixent sur des sites spécifiques pour produire leurs actions pharmacologiques a conduit à l’idée que ces récepteurs devaient avoir un rôle dans l’organisme. Autrement dit, les substances exogènes mimeraient les effets d’une substance endogène. Cela est connu depuis longtemps dans le domaine du système nerveux autonome et a connu un grand succès récemment avec les morphinomimétiques. Au début des années soixante-dix ont été mis en évidence dans le cerveau des Vertébrés des récepteurs opiacés, et, en 1975, furent isolés du cerveau des Mammifères des polypeptides ayant les actions de la morphine: les enképhalines et endorphines. La même démarche est actuellement suivie pour d’autres classes pharmacologiques.En général, pour les substances endogènes plusieurs types de récepteurs existent; la synthèse chimique de substances analogues à celles-ci permet la classification des récepteurs. Celle-ci doit être considérée actuellement comme provisoire.L’action d’une substance sur deux types de récepteurs peut donner lieu au phénomène connu sous le nom d’inversion des effets. Ainsi, l’adrénaline agit sur les récepteurs 見 vasoconstricteurs et les récepteurs 廓2 vasodilatateurs. L’action sur les premiers prédomine habituellement, mais en présence d’une substance bloquant les récepteurs 見, comme la phentolamine ou la phénoxybenzamine, l’action vasoconstrictrice ne peut se révéler; en revanche, l’action sur les récepteurs 廓2 provoque la vasodilatation; les effets vasoconstricteur et hypertenseur de l’adrénaline sont inversés. Par contre, la noradrénaline n’agissant pas sur les récepteurs 廓2, ses actions sont supprimées, mais non inversées par les 見-adrénolytiques.Des recherches très actives visent à élucider la structure chimique des récepteurs. Dans le cas du récepteur cholinergique, les études poursuivies sur la plaque électrique des poissons comme la gymnote ou la torpille ont permis de montrer, par le biais des affinités des agonistes et des antagonistes, qu’il est similaire, sinon identique, à celui de la plaque neuromusculaire des Vertébrés. L’utilisation d’une toxine, d’un serpent du genre Bothrops, l’ 見-bungarotoxine, qui se lie de façon irréversible à ce récepteur, a permis de suivre son isolement. L’emploi d’une autre toxine, cette fois isolée de la peau d’une grenouille de Colombie, l’histrionicotoxine a permis de montrer que ce récepteur était formé de deux entités. L’histrionicotoxine empêche les réactions pharmacologiques provoquées par les agonistes cholinergiques, mais n’empêche pas leur fixation sur les récepteurs. Une des entités est la protéine réceptrice elle-même, la seconde est appelée modulateur de conductance ionique et sa déformation, entraînée par celle de la protéine réceptrice, permet le passage des ions sodium et potassium à travers un canal. Le poids moléculaire de la protéine réceptrice est de 200 000 daltons, et elle est formée de cinq ou six sous-unités de poids moléculaire 46 000. Le modulateur de conductance ionique est constitué de deux sous-unités de 43 000 daltons ce qui lui donne un poids moléculaire de 100 000 daltons (fig. 1). Les rapports entre constitution chimique et activité pharmacologique permettent parfois de se faire une image de l’interaction drogue-récepteur. Ces études ont conduit à la conclusion qu’une molécule douée de propriétés pharmacologiques possède certains groupements chimiques capables de se combiner avec le récepteur. Dans cette optique, l’acétylcholine s’unirait au récepteur par sa fonction ester et sa fonction ammonium quaternaire, mais seule cette dernière conférerait l’activité. En outre, on a identifié comme récepteur des sites localisés sur des enzymes. Il serait ainsi pour l’ésérine qui inhibe les cholinestérases, enzymes hydrolysant l’acétylcholine en acide acétique et choline. Parfois l’activation du récepteur est couplée avec celle d’une enzyme, bien qu’il s’agisse de deux entités distinctes. Ainsi, l’activation du récepteur 廓-adrénergique, situé sur la face externe de la membrane, entraîne celle de l’adénylcyclase localisée à la face interne de la membrane. Cela a pour conséquence la formation d’acide 3 5 adénylique cyclique qui, à son tour, active les kinases intracellulaires et se comporte comme un second messager.Mécanismes d’actionLa conséquence ultime de l’action des médicaments s’exerce en dernier ressort sur les chaînes métaboliques; mais, dans la plupart des cas, les influences des drogues sur le métabolisme sont encore mal connues.Action des médicaments sur les systèmes enzymatiquesCertains médicaments perturbent l’activité de diverses enzymes , qui catalysent soit la dégradation d’une substance physiologique (inhibition des cholinestérases, enzymes qui hydrolysent l’acétylcholine, rend compte de la plupart des propriétés des anticholinestérasiques: ésérine et néostigmine), soit sa biosynthèse (inhibiteurs de la dopa-décarboxylase et de la dopamine- 廓-oxydase, enzymes jouant un rôle dans la formation des catécholamines).Ces résultats, obtenus in vitro sur des systèmes enzymatiques plus ou moins purifiés, ont rendu de grands services à la recherche systématique et rationnelle des médicaments. En effet, une fois le système enzymatique isolé, on peut essayer rapidement beaucoup de drogues nouvelles et sélectionner les plus efficaces. Toutefois, l’action d’un médicament sur les systèmes enzymatiques est, bien souvent, secondaire.Action des médicaments sur un mécanisme physiologiqueL’action d’un médicament peut aussi s’expliquer par son intervention directe dans les chaînes métaboliques . En effet, certains médicaments sont des substrats, comme les acides aminés, de faux substrats, comme l’alcool éthylique, ou des vitamines hydrosolubles, constituants des enzymes essentielles pour les processus métaboliques (cf. ENZYMES, MÉTABOLISME, VITAMINES). La chimiothérapie a exploité cette propriété des drogues. En effet, certains micro-organismes pathogènes ont besoin d’acide folique, facteur de croissance qu’ils sont capables de synthétiser à partir de l’acide para-aminobenzoïque (PAB) puisé dans le milieu environnant. Les sulfamides, possédant une structure très voisine de celle du PAB, se substituent à ce dernier, et le microbe fabrique alors un faux acide folique, inutilisable pour son métabolisme. Mais c’est surtout dans la thérapeutique de certains cancers que ce mécanisme d’action a été utilisé avec succès.On peut citer enfin les médicaments qui sont des enzymes; c’est le cas de la L-asparaginase prescrite dans le traitement des leucémies aiguës de l’enfant. En effet, les cellules leucémiques, mises en présence de cette enzyme, meurent, car elles ne sont pas capables, contrairement aux cellules saines, de synthétiser l’asparagine endogène, tandis que l’asparagine exogène fournie par le milieu extérieur est détruite par l’asparaginase. La cellule sensible manque d’asparagine-synthétase.Action des médicaments sur les surfaces cellulairesLes membranes cellulaires sont capables de sélectionner les substances, même physiologiques, nécessaires à l’économie de la cellule. On a donc pensé que, à quelques exceptions près, la plupart des médicaments ne pénètrent pas à l’intérieur des cellules, mais exercent leurs actions en se fixant sur la membrane, permettant ainsi soit d’induire des effets à l’intérieur même de la cellule, soit de modifier la perméabilité des cellules à certaines substances. Quelques expériences plaident en faveur de cette théorie. L’ouabaïne (cardiotonique) introduite à faible dose dans un liquide où baigne une cellule cardiaque réduit d’une façon significative les mouvements des ions sodium, qui, à l’état normal, rentrent et sortent constamment de cette cellule. En revanche, une solution d’ouabaïne cent fois plus concentrée, injectée directement à l’intérieur de la cellule, n’entraîne pas de perturbations des mouvements normaux des ions sodium. Toutefois, quelques drogues exercent leurs effets à l’intérieur des cellules.Interactions de deux substances pharmacologiquesLes interactions des drogues constituent l’un des chapitres essentiels de la pharmacologie. L’action d’une substance pharmacologique peut être perturbée par l’administration antérieure ou simultanée d’une autre substance. La théorie des récepteurs est encore à la base de l’interprétation de divers phénomènes tels que la synergie, l’inversion, l’antagonisme (fig. 2).En effet, vis-à-vis d’un type de récepteur donné, deux qualités caractérisent un médicament: son affinité , c’est-à-dire la possibilité qu’il a de se fixer sur le récepteur; son activité intrinsèque définie par le résultat de l’interaction médicament-récepteur. Si cette activité intrinsèque est élevée, la drogue est dite agoniste (fig. 2 a); si elle est nulle, la drogue exerce un effet antagoniste. Si deux médicaments, l’un agoniste et l’autre antagoniste, sont placés face au même récepteur, deux cas peuvent se présenter:– L’antagoniste non compétitif se fixe sur un lieu différent du récepteur et déforme celui-ci. L’interaction récepteur-drogue est très perturbée et l’activité de la drogue diminuée: la courbe dose-action est déplacée vers la droite et le maximum diminué (fig. 2 b). Ce concept dérive de la théorie des protéines allostériques de J. Monod, J.-P. Changeux et F. Jacob (1963).– Le résultat dépend de la concentration relative des deux drogues; il s’agit d’un antagonisme compétitif (fig. 2 c). Ainsi, l’atropine abolit l’action de l’acétylcholine sur les fibres lisses innervées par le système parasympathique en entrant en compétition avec le médiateur chimique au niveau des récepteurs. C’est par un mécanisme identique que les anti-histaminiques suppriment les actions de l’histamine [cf. HISTAMINE ET ANTIHISTAMINIQUES DE SYNTHÈSE].La synergie est l’addition d’action de médicaments; la potentialisation est le renforcement en rapidité, intensité ou durée des effets de deux médicaments administrés conjointement. La compétition entre les molécules d’acétylcholine et d’ésérine vis-à-vis du site actif de la cholinestérase, par suite d’une certaine analogie de structure, inhibe l’action de cette enzyme; l’ésérine renforce donc l’effet de l’acétylcholine: la contraction musculaire est plus durable.Les interactions ont permis une meilleure classification des récepteurs. Elles sont essentielles à connaître pour le médecin.Sort des médicaments dans l’organismeLe sort des médicaments dans l’organisme (absorption, distribution, métabolisme, excrétion) a été particulièrement bien étudié par les pharmacologues et les biochimistes [cf. MÉDICAMENTS]. Le passage du médicament à travers les membranes biologiques peut être soit passif, conditionné par la liposolubilité, soit actif. Dans les deux cas, il semble mettre en jeu des systèmes de transport qui utilisent des molécules porteuses pouvant faciliter la migration de la drogue à travers les membranes.La transformation de la drogue en composé actif ou inactif est un phénomène biochimique. Elle fait appel à des réactions d’hydrolyse, d’oxydation, de réduction, catalysées par les enzymes du métabolisme intermédiaire, ou de conjugaison mettant en jeu un métabolisme particulier, système de défense de la cellule, hépatique notamment.Structure chimique et activité pharmacologiqueLa recherche des lois qui lient l’activité pharmacologique à la structure chimique renseigne par exemple sur la nature de l’interaction de la drogue et du récepteur, et facilite la recherche de nouveaux médicaments. En effet, de faibles modifications de la structure chimique peuvent influencer considérablement l’activité pharmacologique.Parmi les approches indirectes, on n’abordera ici que celle reposant sur l’étude de la structure chimique des agonistes et des antagonistes. On peut considérer un récepteur donné, par exemple situé au niveau des artérioles. La noradrénaline, agoniste physiologique de ce récepteur, mise au contact de ces vaisseaux, entraîne une contraction. De nombreuses substances vasoconstrictrices ont été synthétisées; leur affinité et leur activité intrinsèque ont été définies. De même, des antagonistes compétitifs de la noradrénaline et des agonistes de synthèse ont été fabriqués. L’étude fine de la configuration spatiale de ces molécules permet de mettre en évidence, chez tous les agonistes, une structure commune, qui serait responsable de l’activité pharmacologique, et qui représenterait ainsi l’équivalence d’une fiche mâle se fixant sur le récepteur, fiche femelle. Cette conception permettrait de supposer la configuration du récepteur.Les antagonistes présentent également une structure commune, assez voisine de celle des agonistes, mais différente par un point. Ainsi, la fixation de l’antagoniste sur le récepteur est possible, mais n’entraînerait pas de résultat. Il existerait donc une partie de la surface du récepteur au niveau de laquelle l’activation aurait lieu.On a pu de cette façon, grâce à l’étude des rapports qui existent entre les structures chimiques de nombreux médicaments et leur activité pharmacologique, confirmer la valeur de la notion de récepteur et avoir une idée de la structure de beaucoup d’entre eux (cf. RÉCEPTEURS MEMBRANNAIRES).Une application pratique consisterait, une fois connue la structure des récepteurs, à fabriquer des molécules aussi bien adaptées que possible, et cette méthode permettrait la préparation logique de médicaments à action spécifique.Toutefois, les lois qui lient l’activité et la structure sont encore bien peu satisfaisantes, tant que ne sera pas connue la structure réelle des récepteurs. En outre, la recherche de nouvelles drogues demeure très empirique. En fait, pour l’instant, la physicochimie fournit encore aux chercheurs peu de renseignements sur les rapports entre structure chimique et propriétés physicochimiques, sur la répartition électronique et la structure spatiale (cf. biochimie QUANTIQUE).0. Pharmacologie et physiologieCes problèmes propres à la pharmacologie ne doivent pas masquer l’apport essentiel de la pharmacologie à la physiologie générale. On ne citera que quelques exemples. La théorie de la transmission neurohumorale de l’influx nerveux, bien établie aujourd’hui, est due à l’œuvre de pharmacologues (H. Dale, T. R. Elliot, O. Loewi, W. B. Cannon, U. S. von Euler) qui sont restés en butte pendant quarante ans aux objections des physiologistes. Les chémorécepteurs ont été découverts grâce à l’action des drogues pharmacologiques. Les curarisants, les ganglioplégiques, les 廓 bloqueurs, les adrénolytiques 見 ont puissamment contribué à la connaissance des mécanismes de transmission au niveau de la plaque neuromusculaire, du ganglion, des jonctions du système sympathique. L’ouabaïne inhibe la «pompe» à sodium dans les tissus; la tétrodotoxine réduit spécifiquement l’augmentation de la perméabilité au sodium durant le potentiel d’action. Ces drogues sont de précieux «outils de dissection physiologique», comme le disait déjà Claude Bernard, pourvu que la connaissance de leurs propriétés pharmacologiques mette à l’abri des erreurs d’interprétation. Il en est de même des anticholinestérasiques, des inhibiteurs de l’anhydrase-carbonique, de la monoamine-oxydase. La 6-hydroxydopamine provoque, à des doses déterminées, la dégénérescence des fibres sympathiques, et réalise, au niveau de certains organes au moins, une sympathectomie chimique. On conçoit l’importance des antagonistes pour étudier le rôle d’un corps naturel. Le concept de second médiateur chimique, d’une part, entre l’hormone et l’effet final (3 ,5 -AMP cyclique), d’autre part, entre les processus de dépolarisation de la membrane cellulaire et la contraction musculaire (Ca2+), doit beaucoup aux expériences pharmacologiques.La découverte de nombreux polypeptides, tels que la bradykinine, la substance P, l’angiotensine, des prostaglandines, de la 5-hydroxytryptamine, de l’histamine, est l’œuvre des pharmacologues. Ces substances ont d’abord été des curiosités pharmacologiques sur lesquelles a ensuite porté la réflexion physiologique. La pharmacologie a ainsi ouvert de nouveaux chapitres à la physiologie.S’il est banal de reconnaître l’apport pharmacologique dans le métabolisme des catécholamines, de l’acétylcholine, de la 5-hydroxytryptamine, il faut aussi remarquer que les études sur le métabolisme intermédiaire effectuées avec des inhibiteurs enzymatiques sont faites dans un esprit pharmacologique.0. Pharmacologie cliniqueLa pharmacologie clinique se propose de mieux connaître les effets des médicaments chez l’homme et leur valeur thérapeutique. Son objet est encore assez imprécis, et certains en font une panacée, d’autres au contraire n’y voient qu’une duplication des expériences de pharmacologie fondamentale. Entre ces deux extrêmes, une opinion plus modérée et une plus juste appréciation des buts de la discipline peuvent permettre de définir sa place exacte [cf. PHARMACOLOGIE CLINIQUE].
pharmacologie [ farmakɔlɔʒi ] n. f.• 1738; on disait la pharmaceutique; de pharmaco- et -logie♦ Didact. Étude des médicaments, de leur action (propriétés thérapeutiques, etc.) et de leur emploi. ⇒ pharmacie, pharmacocinétique, pharmacodynamie, pharmacothérapie; psychopharmacologie. — Adj. PHARMACOLOGIQUE , 1803 .
● pharmacologie nom féminin Branche des sciences médicales qui étudie les propriétés chimiques des médicaments et leur classification.pharmacologien. f. Didac. Science qui étudie les médicaments, leur composition, leur mode d'action, leur posologie, etc.⇒PHARMACOLOGIE, subst. fém.Science des médicaments. Pharmacologie expérimentale, qualitative, quantitative; pharmacologie synthétique; pharmacologie cardiaque. La pharmacologie se propose d'abord de découvrir de nouvelles drogues. Elle cherche ensuite à localiser leur lieu d'action et à comprendre le mécanisme de cette dernière (Encyclop. univ. t.12 1972, p.920). La pharmacologie comprend: la matière médicale, la chimie pharmaceutique, la pharmacie galénique, la toxicologie et la pharmacodynamie (Méd. Flamm. 1975):• ♦ ... jusqu'au milieu du XIXe siècle, la plupart des drogues restent d'origine végétale, (...) les choses changent quand, pour la première fois, Schaefer découvre, dans les tissus animaux, une autre source capitale de médicaments actifs. Depuis, l'histoire de la pharmacologie et son évolution ont été ce que l'on sait...R. SCHWARTZ, Nouv. remèdes et mal. act., 1965, p.12.♦Pharmacologie clinique. ,,Étude de l'effet des médicaments chez l'homme malade`` (Méd. Biol. Suppl. 1982).REM. -pharmacologie, élém. de compos. a) Dermopharmacologie, subst. fém. ,,Discipline qui étudie toutes les applications de la pharmacologie concernant les téguments`` (GDEL). b) Neuropharmacologie, subst. fém. ,,Chapitre de la pharmacologie qui concerne l'action des drogues, ou substances pharmacologiques, sur les nerfs et le système nerveux central`` (Encyclop. univ. t.11 1972, p.740). c) Psychopharmacologie, subst. fém. ,,Étude de l'action des substances médicamenteuses sur les fonctions psychiques`` (Méd. Biol. t.3 1972, s.v. pharmacopsychologie, synon.). Le contrôle chimique du comportement est l'objet de la psychopharmacologie. Cette nouvelle discipline dont le nom apparaît en 1956, est née de la rencontre des sciences du comportement et de la pharmacologie, science des actions médicamenteuses, en raison surtout des acquisitions de la chimie moderne (P. DENIKER, La Psychopharmacologie, 1969 [1966], p.5). Psychopharmacologique, adj., dér. Qui concerne, qui relève de la psychopharmacologie. Méthodologie psychopharmacologique (P. DENIKER, La Psychopharmacologie, 1969 [1966], p.15). d) Toxico-pharmacologie, subst. fém. Étude de l'action des toxiques sur l'organisme. Novateur, Magendie l'a (...) été avant l'heure dans de nombreux domaines: dans celui de la toxico-pharmacologie comme dans ceux de la physiologie ou de la biochimie expérimentales (BARIÉTY, COURY, Hist. méd., 1963, p.659)Prononc. et Orth.:[ ]. Att. ds Ac. 1935. Étymol. et Hist.1. 1738 «théorie des médicaments et de leur emploi; traité de cette théorie» (Bibliothèque britannique, t.X, p.262, article II: Remarques sur la pharmacologie de W. Dave); 2. 1842 «histoire naturelle et médicale des médicaments» (Ac. Compl.). Comp. des élém. pharmaco- et -logie.DÉR. 1. Pharmacologique, adj. a) Qui est relatif à, qui relève de la pharmacologie. Recherches, travaux pharmacologiques; action pharmacologique d'une drogue. Certains centres scientifiques, surtout américains, opèrent sans idée préconçue et soumettent au plus grand nombre possible d'épreuves d'activité pharmacologique toute molécule chimique nouvelle (R. SCHWARTZ, Nouv. remèdes et mal. act., 1965, p.13). b) Qui exerce une action, qui a une activité propre aux médicaments. L'action de substances pharmacologiques ou toxiques manifeste des dissociations très nettes. (...) si la cocaïne abolit toutes les saveurs, elle le fait dans un certain ordre, l'amer d'abord, puis le sucré, et, plus tardivement le salé, et enfin l'acide, de fragilité moindre (PIÉRON, Sensation, 1945, p.196). — [
]. Att. ds Ac. 1935. Étymol. et Hist.1. 1738 «théorie des médicaments et de leur emploi; traité de cette théorie» (Bibliothèque britannique, t.X, p.262, article II: Remarques sur la pharmacologie de W. Dave); 2. 1842 «histoire naturelle et médicale des médicaments» (Ac. Compl.). Comp. des élém. pharmaco- et -logie.DÉR. 1. Pharmacologique, adj. a) Qui est relatif à, qui relève de la pharmacologie. Recherches, travaux pharmacologiques; action pharmacologique d'une drogue. Certains centres scientifiques, surtout américains, opèrent sans idée préconçue et soumettent au plus grand nombre possible d'épreuves d'activité pharmacologique toute molécule chimique nouvelle (R. SCHWARTZ, Nouv. remèdes et mal. act., 1965, p.13). b) Qui exerce une action, qui a une activité propre aux médicaments. L'action de substances pharmacologiques ou toxiques manifeste des dissociations très nettes. (...) si la cocaïne abolit toutes les saveurs, elle le fait dans un certain ordre, l'amer d'abord, puis le sucré, et, plus tardivement le salé, et enfin l'acide, de fragilité moindre (PIÉRON, Sensation, 1945, p.196). — [ ]. — 1re attest. 1803 (BOISTE); de pharmacologie, suff. -ique. 2. Pharmacologiste, pharmacologue, subst. Spécialiste de pharmacologie. Une hypothèse de travail assez courante consiste à s'inspirer de molécules actives et à modifier, selon l'inspiration du moment, tel ou tel atome, ajoutant là un carbone, supprimant ici un chlore, etc. Le nouveau corps synthétisé va alors passer des mains du chimiste dans celles du pharmacologue, dont la tâche capitale consistera à donner une idée de l'activité du produit sur l'organisme animal (R. SCHWARTZ, Nouv. remèdes et mal. act., 1965, p.14). — [
]. — 1re attest. 1803 (BOISTE); de pharmacologie, suff. -ique. 2. Pharmacologiste, pharmacologue, subst. Spécialiste de pharmacologie. Une hypothèse de travail assez courante consiste à s'inspirer de molécules actives et à modifier, selon l'inspiration du moment, tel ou tel atome, ajoutant là un carbone, supprimant ici un chlore, etc. Le nouveau corps synthétisé va alors passer des mains du chimiste dans celles du pharmacologue, dont la tâche capitale consistera à donner une idée de l'activité du produit sur l'organisme animal (R. SCHWARTZ, Nouv. remèdes et mal. act., 1965, p.14). — [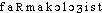 ], [-
], [- ]. — 1res attest. a) 1799 pharmacologiste (PARMENTIER, Réflexions sur les vins médicinaux ds Ann. chim. et phys., t.35, p.63), b) 1836 pharmacologue (Ac. Suppl., p.616); a de pharmacologie, suff. -iste, b comp. des élém. pharmaco- et -logue.pharmacologie [faʀmakɔlɔʒi] n. f.ÉTYM. 1738 (on disait la pharmaceutique); de pharmaco-, et -logie.❖♦ Didact. Étude des médicaments, de leur action (propriétés thérapeutiques, etc.) et de leur emploi. ⇒ Pharmacie, pharmacodynamie, pharmacothérapie; psychopharmacologie.➪ tableau Noms de sciences et d'activités à caractère scientifique.❖DÉR. Pharmacologique, pharmacologiste ou pharmacologue.
]. — 1res attest. a) 1799 pharmacologiste (PARMENTIER, Réflexions sur les vins médicinaux ds Ann. chim. et phys., t.35, p.63), b) 1836 pharmacologue (Ac. Suppl., p.616); a de pharmacologie, suff. -iste, b comp. des élém. pharmaco- et -logue.pharmacologie [faʀmakɔlɔʒi] n. f.ÉTYM. 1738 (on disait la pharmaceutique); de pharmaco-, et -logie.❖♦ Didact. Étude des médicaments, de leur action (propriétés thérapeutiques, etc.) et de leur emploi. ⇒ Pharmacie, pharmacodynamie, pharmacothérapie; psychopharmacologie.➪ tableau Noms de sciences et d'activités à caractère scientifique.❖DÉR. Pharmacologique, pharmacologiste ou pharmacologue.
Encyclopédie Universelle. 2012.
